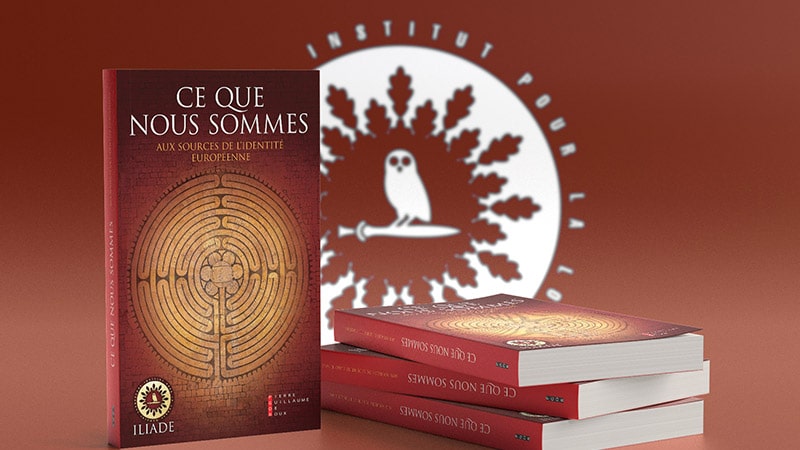Les voix de la forêt : le sentiment européen de la nature
Extrait de l’ouvrage collectif de l’Institut ILIADE Ce que nous sommes — Aux sources de l’identité européenne, par Eric Grolier (Pierre-Guillaume de Roux éditeur, lancement officiel à l’occasion du colloque annuel de l’ILIADE, le 7 avril 2018 à Paris).
« Dans la feuillée, écrin vert taché d’or,
Dans la feuillée incertaine et fleurie
De fleurs splendides où le baiser dort,
Vif et crevant l’exquise broderie,Un faune effaré montre ses deux yeux
Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches
Brunie et sanglante ainsi qu’un vin vieux
Sa lèvre éclate en rires sous les branches.Et quand il a fui – tel qu’un écureuil –
Son rire tremble encore à chaque feuille
Et l’on voit épeuré par un bouvreuil
Le Baiser d’or du bois, qui se recueille. »
Arthur Rimbaud, Tête de faune
Ce n’est pas un poète chinois, arabe ou wolof qui a écrit ces vers.
De la même manière, la musique du phrasé rimbaldien n’évoque pas les notes d’un shamisen japonais ou les sons d’un shehnai indien, mais la symphonie de L’Après-midi d’un faune d’un Claude Debussy. Et les visions synesthésiques du poète trouvent un écho dans les toiles de Waterhouse, de Brueghel et de Poussin, pas dans les estampes d’Hokusai ou les miniatures persanes de Chiraz ! Le sentiment de la nature est propre à chaque civilisation que façonnent un environnement spécifique, un champ spirituel original et une histoire particulière.
Dans ses quatrains décasyllabiques, Rimbaud exprime ainsi une triple permanence, caractéristique de la mentalité européenne : celle de la forêt, figure de la pluralité fondamentale de la nature, repaire de tous les mystères et de tous les possibles – de toutes les libertés ; celle du monde habité par le divin – un monde définitivement immanent ; celle enfin de la sensualité indissociable du beau – une esthétique complète de vie.
Deux mille cinq cents ans plus tôt, Alcée de Lesbos célébrait le retour d’Apollon à Delphes en des termes d’une formidable proximité :
« Douze mois de l’année avant ton doux retour.
Enfin tu reparus ! C’était le plus beau jour
D’un bel été, et les rossignols, les arondes
Chantaient, criaient de joie, et tes cigales blondes
Crissaient en ton honneur ; et les sources coulèrent
Et les fleuves luisant, Castalie aux eaux pures,
Et le Céphise heureux, enflant sa vague, surent
Que le dieu revenait… »
À l’époque d’Alcée, quand leur terre était encore riche d’arbres, de rivières et d’oiseaux, les Grecs étaient poètes, philosophes, tragédiens et savants. Ils avaient pu tourner leur attention vers l’homme, parce que la nature était encore vivante et habitée.
Quand s’émeut-on du sort d’une chose ? Quand celle-ci est menacée ou déjà morte. L’absence d’une expression du sentiment de nature ne révèle aucune indifférence, mais au contraire une empathie, une connaissance et surtout une connexion que nous avons peine aujourd’hui à imaginer.
De la même manière que Déméter était la moisson et Arès était la guerre, les hommes étaient la nature et ne témoignaient que de son dynamisme. Quand « il suffit de nommer l’Hamadryade pour entendre bruire les feuilles » (Marguerite Yourcenar), le sentiment de la nature est si évident qu’il serait vain de le définir.
À la même époque qu’Alcée, au VIIe siècle av. J.-C., le poète Alcman de Sparte avait appris, disait-on, à composer ses chants en écoutant le cri des perdrix. Quelques-uns de ses vers, emplis d’une poignante mélancolie, viennent nous rappeler que nous sommes toujours les modernes de plus anciens que nous et que le sentiment de nature, avant de trouver son exaltation dans les principes polythéistes (et une forme de survivance sous le manteau chrétien), était intrinsèquement lié à l’animisme.
« Ils dorment, les sommets et les ravins profonds
Et les forêts, les précipices, la vallée,
Et les êtres rampants qui naissent de la terre,
Et la bête des bois en son lit solitaire,
Et les abeilles, race ailée ;
Et dans la sombre mer, sous l’écume et la houle,
Les monstres écaillés, et la légère foule
Des vifs oiseaux sous la feuillée… »
Car la nature n’est pas seulement sentiment d’appartenance ou motif d’exaltation.
Elle est le siège de puissances, bénéfiques ou maléfiques, qu’il convient avant toute chose de se concilier. Ce fut le rôle des pratiques chamaniques pré-historiques, opérées par des légions d’initiés dans l’espace européen durant des dizaines de milliers d’années. Les sorciers, peints dans les grottes, à l’origine peut-être des figures d’Odhinn-Wotan (Odhinn qui reçut les runes suspendu à un arbre et la sagesse en buvant à une source, Odhinn et sa Chasse sauvage) et plus tard de Merlin-Myrddin, étaient entièrement liés à la nature qu’ils interrogeaient, utilisaient et conjuraient.
La Völuspá, transmise notamment par le Codex Regius de l’Edda Poétique (ensemble de poèmes norrois composés entre le IXe et le XIIIe siècles), ne cesse d’invoquer une nature matrice de l’existant :
« Un frêne se dresse, je le sais, appelé Yggdrasill,
Arbre altier, aspergé
De blanche boue ;
De là viennent les gouttes de rosée
Qui tombent dans les vallées.
Eternellement vert, il se dresse
Au-dessus de la source d’Urd.
De là sont venues les vierges,
Savantes en maintes choses :
Trois, sorties de l’onde
Qui jaillit sous l’arbre ;
Urd se nomme l’une,
L’autre Verdandi.
Elles gravèrent les tablettes de bois.
Skuld est la troisième.
Elles firent les lois,
Choisirent le sort
Des fils des hommes,
Le destin des guerriers ».
À l’autre bout de l’espace européen, le Kat Godeu ou Combat des Arbres, attribué par certains au barde historique gallois Taliesin (VIe siècle) et révélateur quoi qu’il en soit du vieil esprit celte, décline le registre de la nature enchantée, sollicitée ou combattue par les hommes, sur des champs de bataille rendus possibles par la proximité des différents plans d’existence au sein d’un même ensemble – la nature :
« J’ai été à Caer Nevenydd.
Là où l’herbe et les arbres se hâtent.
Des guerriers chantaient.
Des guerriers attaquaient. […]
Les aulnes en tête de ligne
Avancent les premiers.
Les saules et les sorbiers
Tardivement, vinrent dans les rangs.
Les pruniers aux épines
Inopportunes aux hommes.
Les néfliers vigoureux
Triompheront de l’ennemi.
Les rosiers marchèrent
Contre une horde de géants.
Les framboisiers firent miracle.
Pas de meilleure nourriture
Pour soutenir la vie.
Le troène et le chèvrefeuille,
Avec le lierre devant eux,
Foncèrent à l’enclos du combat. […] »
Mais un sentiment ne vaut que s’il existe des hommes pour l’éprouver.
Que reste-t-il aujourd’hui, en Europe, de cette nature matricielle, enchantée et célébrée ? Un texte breton, recueilli dans les années 1820 et immortalisé par Théodore Hersart de la Villemarqué, inspiré par des fragments de chants populaires et d’autres poèmes gallois rattachés cette fois au légendaire barde Myrddin, nous souffle la réponse :
« Du temps où j’étais barde dans le monde,
j’étais honoré de tous les hommes.
Dès mon entrée dans les palais,
on entendait la foule pousser des cris de joie.
Sitôt que ma harpe chantait,
des arbres tombait l’or brillant.
Les rois du pays m’aimaient ;
les rois étrangers me craignaient.
Le pauvre petit peuple disait :
“Chante, Merlin, chante toujours.”
Ils disaient, les Bretons :
“Chante, Merlin, ce qui doit arriver.”
Maintenant, je vis dans les bois ;
personne ne m’honore plus maintenant.
Je l’ai perdue, ma harpe ;
ils sont coupés, les arbres
d’où tombait l’or brillant.
Les rois des Bretons sont morts,
les rois étrangers oppriment le pays.
Les Bretons ne disent plus :
“Chante, Merlin, les choses à venir.”
Ils m’appellent Merlin le fou,
et tous me chassent à coups de pierre. »
Prophétiques, les propos de Merlin annoncent la perversion moderne du sentiment de nature. Perversion dont il ne s’agit pas, ici, d’en énoncer toutes les causes, un livre ne suffirait pas. Mais les coups de boutoir de la pensée monothéiste (« Dieu bénit les hommes et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Gn.1, 27) et ceux du matérialisme consumériste, succédant au Dieu dont Nietzsche a annoncé la mort pour devenir unique horizon, ont durablement étouffé les voix de la forêt – ou rendu sourdes les oreilles qui pouvaient les entendre.
Heureusement, rien n’est perdu tant qu’en Europe resteront des arbres et des Européens. L’écrivain autrichien Adalbert Stifter, qu’admirait Nietzsche, a écrit ceci dans L’Homme sans postérité (1844) :
« Les montagnes, les belles montagnes qui lui avaient tant plu alors qu’il s’en approchait, s’obscurcissaient à présent toujours davantage, et faisaient tomber de sombres taches menaçantes sur la surface de lac que pailletait encore l’or pâle du couchant, parmi les noirs reflets des monts ; tout prenait autour de lui, en s’enveloppant dans les ombres de la nuit, des formes de plus en plus étranges. Le noir et l’or du lac se touchaient et se confondaient comme s’il y passait un léger courant d’air. Le regard de Victor, seulement habitué aux belles et heureuses impressions du jour, ne pouvait pas se détourner de ce spectacle, où les choses imperceptiblement changeaient de couleur en se laissant envelopper par la tranquillité de la nuit. »
Le sentiment de ce jeune homme qui semble perdu dans un tableau de Caspar David Friedrich rejoint celui de Rimbaud dans sa fascination du mystère et de la beauté du monde.
Dans sa sagesse d’homme éternellement libre, Dominique Venner proposait quelques pistes aux modernes pour se retrouver : marcher régulièrement dans la nature, s’immerger dans la splendeur, les parfums, les couleurs, renouer avec la beauté et la poésie – premières ruptures fondamentales avec le monde moderne, premières conditions au réenchantement du monde ; se retirer dans la forêt-sanctuaire, le calme, le silence, et faire la paix avec soi-même ; pérégriner librement, dans l’effort, la camaraderie et le sentiment de liberté ; s’inscrire dans la tradition de rites rythmant l’année et célébrant les cycles naturels. Ces démarches sont plus que jamais nécessaires et d’actualité si nous voulons traverser le siècle sans clore définitivement le chapitre européen de l’histoire du monde.
Car c’est bel et bien avec ce sentiment de la nature, débarrassé de filtres désuets et néfastes, en apprenant à entendre de nouveau les voix de la forêt, que nous nous sauverons et réintégrerons notre cosmos, cette image de l’univers qui nous est propre – un univers ordonné, accordé à nous-mêmes.
« Le ciel et la terre, les Dieux et les hommes sont liés entre eux par une communauté, faite d’amitié et de bon arrangement, de sagesse et d’esprit de justice, et c’est la raison pour laquelle à cet univers est donné le nom de cosmos, d’arrangement, et non celui de dérangement non plus que de dérèglement. » (Platon, Gorgias)
Nous nous sauverons physiquement, en accordant de nouveau à la nature le respect que l’on doit à ce dont on est indissociablement lié.
Nous nous sauverons spirituellement, en retrouvant notre capacité d’émerveillement, voie royale à la perception d’un monde pluriel et enchanté où retentira de nouveau le rire des faunes.
Eric Grolier
Crédit photo : © Institut ILIADE