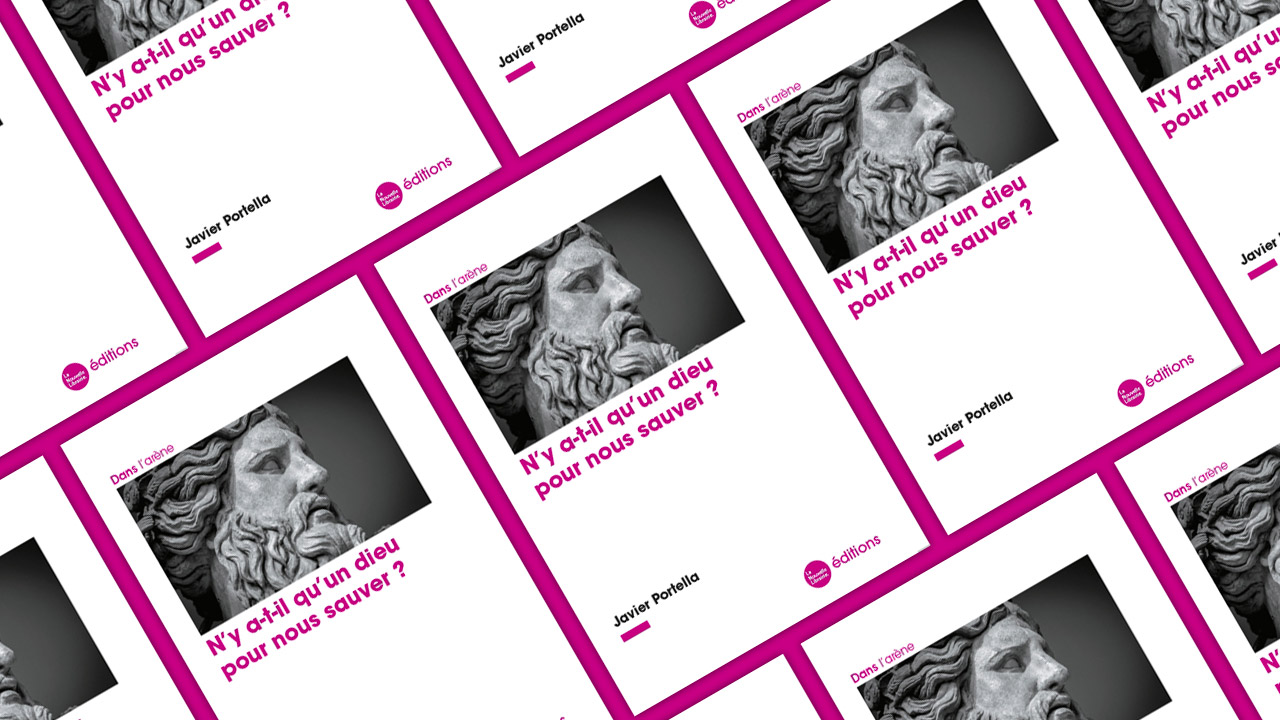N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver ?
Dans son dernier ouvrage, Javier Portella nous emmène à la recherche du divin ayant déserté notre monde.
« N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver ? ». Ce questionnement, qui fait implicitement référence à l’affirmation d’Heidegger sur le sujet, qui elle-même faisait suite à la mort de Dieu affirmée par Nietzsche, constitue le cœur de toute réflexion contemporaine sur la question du sacré et de sa disparition. Réflexion à laquelle nous convie Javier Portella.
Liberté et démocratie ?
Que l’évanouissement du divin dans le cœur des Européens soit le fruit du concile Vatican II, de la disparition du monde paysan, du triomphe de la Raison sur la Foi porté par les Lumières, de la montée en puissance de la bourgeoisie depuis la Renaissance jusqu’à l’avènement de la société de consommation sont autant de pistes à explorer qui mériteraient chacun plusieurs ouvrages leur étant consacrés.
Mais aujourd’hui, il nous importe surtout de savoir non pas comment ce triomphe du matérialisme et du nihilisme a pu advenir mais surtout sous quelles formes il se manifeste, il s’incarne. « La liberté et la démocratie », nous matraque-t-on. « L’hédonisme débridée et le libéralisme », doit-on plutôt comprendre. À présent, voici nos points de départ nous dit Javier Portella. Notre époque est horrible, mais nous ne pouvons faire comme si celle-ci pouvait être balayée d’un revers de la main ou que nous pourrions nous persuader qu’il est possible de revenir en arrière.
Le divin a quitté ce monde mais nous ne pouvons vivre sans lui nous rappelle Javier Portella. Mais alors, comment le faire revenir alors que les conditions de son établissement ne sont plus réunies ? Ces conditions sont cependant celles du passé, aussi glorieux qu’il ait pu être. Si nous croyons que le divin ne peut prendre qu’une seule forme, qu’il se doit d’être le plus littéral possible, ne peut s’incarner dans une dimension qui serait purement poétique, allégorique, alors nous nous condamnons à n’être capable que de contempler ce glorieux passé.
« Dieu est mort » nous disait Nietzsche. Le philosophe avait averti par ces quelques mots que les progrès de la science, de la raison, que les connaissances scientifiques accumulées depuis maintenant des siècles sur le monde physique avaient poussé Dieu, le sacré dans les retranchements les plus transcendantaux de ce qui était devenu la religion des Européens, la religion chrétienne. Le rapport sacré, magique au monde et qui voyait dans la main de Dieu ou des dieux l’explication tout comme le dévoilement de celui-ci disparaissait devant ceux glacés de la science, de la technique et du taux d’intérêt. Dans ce XIXe siècle finissant qui voyait s’amorcer le triomphe des villes, de l’industrie et des idéaux démocratiques, Nietzsche présentait bien qu’il ne resterait bientôt plus de place pour le divin dans le cœur des hommes. Tout du moins, pas selon les modalités qui avaient prévalues jusqu’à lors.
Une déterminante indétermination
À la suite du philosophe au marteau, nombreux furent ceux qui recherchèrent les outils permettant de forger un nouveau sacré puis d’accueillir ce dieu tant attendu pour l’incarner. Javier Portella est de ceux-ci. Scrutant avidement le monde d’un œil poétique, Javier Portella nous pousse à nous interroger sur ce qui fonde intemporellement le sacré tout comme à prendre en compte l’environnement (le monde actuel) qui pourra l’accueillir et donc les limitations qu’il lui imposera. Ce monde qui est le nôtre étant de la plus grande des sécheresses sur le plan du sacré, s’interroger sur le sacré dans ce monde ci, c’est rechercher ce qu’il recèle de plus fondamental, sur ce qu’il reste du divin lorsque toute forme de divin a disparu.
Que reste-t-il alors au milieu du désert ? Quelle est cette source que rien ne saurait tarir ? Qu’est-ce qui préside à l’édification de tout sacré, quelle qu’en soit la forme ? Les Anciens l’appelaient Destin, l’Église la nomma Providence. Clément Rosset la nommait Tragique. Javier Portella lui donne le nom d’Indéterminé. Mais quels que soient les termes choisis, ils recouvrent une même réalité.
Nous vivons dans un univers que nous ne pouvons prévoir, imprévisible par nature. Même si nous écartons de plus en plus de nous le spectre de la mort et des maladies, que les guerres et les famines sont virtuellement inconnues des Européens, il n’en reste pas moins que nous sommes mortels, mortels dans un monde qui nous dépasse. Cette mortalité et cette indétermination (et leur absolue nécessité) constituent le fondement de tout sacré.
Voici l’ultime sacré encore capable de susciter dans le cœur des hommes l’aspiration au Beau, au Bon et au Vrai. Au Beau car comme l’enseignait l’Iliade, la contemplation du tragique de l’existence et de son absolue nécessité permet un rapport poétique au monde. Au Bon car nous ne saurions permettre que l’on souille et déprécie un monde que nous savons à présent empli de sacré. Au Vrai car nous n’avons pas seulement abandonné les arrières-mondes, nous avons rejeté jusqu’aux fables du monde moderne nous voyant comme les maîtres absolus de nos existences.
Nous espérons tous un jour voir cette source rejaillir dans toute l’Europe et faire refleurir le désert qu’elle est devenue. Au détour d’un bois, qui sait, peut-être un jour l’apercevrons-nous enfin ce dieu que nous avons tant attendu…
Adrien – Promotion Dominique Venner
Javier Portella, N’y a-t-il qu’un dieu pour nous sauver ?, éditions de La Nouvelle Librairie, 2021