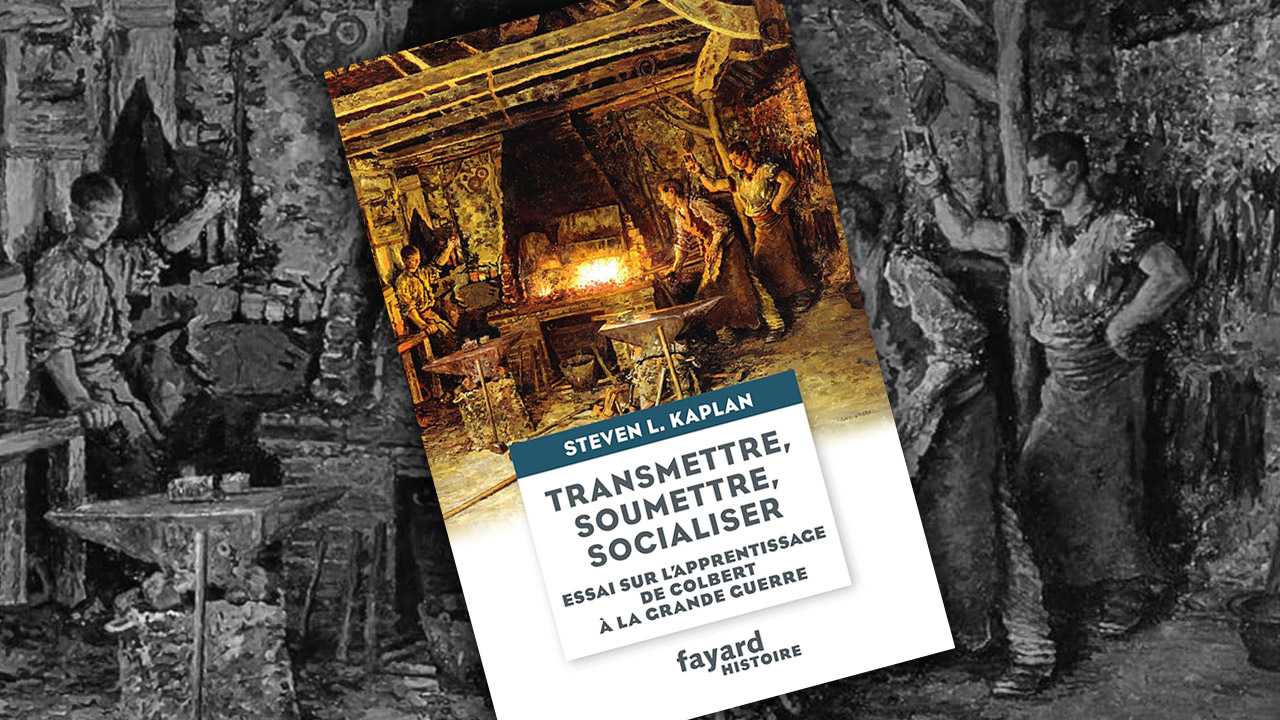Transmettre, Soumettre, Socialiser de Steven L. Kaplan
À l’heure où l’on parle de réindustrialisation de la France et de revalorisation de l’apprentissage, l’ouvrage de l’historien américain Steven L. Kaplan vient dresser un panorama instructif de l’évolution de ce mode de formation. De sa forme première à l’époque des corporations, à son évolution sous l’effet du libéralisme et son adaptation à la révolution industrielle, il identifie ainsi les grandes problématiques auxquelles l’apprentissage a dû répondre, et les questions qu’il soulève désormais.
Le meilleur moyen de se lancer dans le monde professionnel est-il de faire sa formation en atelier, ou sur les bancs de l’école ? Quelles doivent être les relations entre des maîtres qui transmettent un savoir-faire — sans renier l’impératif de productivité et de production d’une plus-value — et des adolescents dont l’expérience reste fatalement parcellaire ?
Le choix de proposer une vaste fresque historique, sans sacrifier la minutie, le goût du détail, n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage de Steven L. Kaplan. Transmettre, Soumettre, Socialiser : Essai sur l’Apprentissage de Colbert à la Grande Guerre complète ainsi une série de travaux questionnant l’articulation des enjeux économiques, sociaux et politiques : on songe à l’analyse de la libéralisation du marché du grain dans la France d’Ancien Régime (Le complot de famine : histoire d’une rumeur au xviiie siècle, 1982), ou à l’étude des enjeux du « pain » à la veille de la Révolution, entre histoire des mentalités et microhistoire (Le pain, le peuple et le roi : la bataille du libéralisme sous Louis XV, 1986 ; Le meilleur pain du monde : les boulangers de Paris au xviiie siècle, 1996).
On est tenté de dire que l’historien américain — et à l’évidence francophile — relève ici un défi. Immergeant son lecteur dans les archives de nombreuses villes françaises, l’ouvrage ne se réduit pas à une sèche analyse des instances de formation et de leur évolution. La présentation des institutions s’accompagne d’un souci. Celui de faire revivre des scènes vécues : ainsi d’un passage devant la police des arts et métiers, à Lyon, au xviie siècle ; ou d’un jugement devant les prud’hommes de Tours au xixe siècle. Qu’il soit ou non familier de l’univers de l’apprentissage, le lecteur conçoit qu’il n’a pas toujours pris la forme des lycées professionnels contemporains. Véritable rite de passage, du seuil de la Modernité à la période contemporaine, il est susceptible d’inspirer de nouvelles réglementations et pratiques.
L’histoire de l’apprentissage, entre dynamiques techniques, économiques et politiques, est pourtant complexe. S’il trouve son origine dans les corporations de métiers — issues des corps intermédiaires déjà vivaces au Moyen-Âge —, il se retrouve sous le feu des critiques et mesures « libérales » au xixe siècle. Plusieurs tentatives de réforme ou restructuration eurent pourtant lieu sous l’Ancien Régime, dont la plus connue reste sans doute celle de Turgot en 1776, qui diminua le nombre des corporations tout en accroissant la marge de manœuvres des ouvriers formés hors des instances traditionnelles. On sait que les corporations subirent pourtant un coup d’arrêt définitif durant la Révolution française : d’abord avec la loi d’Allarde puis avec la loi Le Chapelier (1791), qui interdirent purement et simplement toutes les coalitions ouvrières.
L’apprentissage — indissociable jusque-là des corporations — ne disparut pas pour autant. C’est qu’il présentait l’avantage d’encadrer matériellement et de structurer symboliquement la formation des jeunes gens, canalisant une énergie susceptible de désorganiser en d’autres contextes la société. On conçoit que des auteurs majeurs aient dès lors, au cours du xixe siècle, multiplié les arguments en faveur d’un renouveau des corporations — ainsi du légitimiste René de la Tour du Pin ou d’Auguste Beignet, jusqu’à Louis Million d’option plus libérale.
Sans doute l’apprentissage a-t-il fortement participé à structurer la société. Placer son enfant chez un maître — souvent un proche, ou une personnalité jouissant de la reconnaissance publique — pouvait s’avérer déterminant pour son avenir. Compte tenu de l’opacité des divers « métiers », il restait cependant difficile de connaître la nature exacte des tâches que l’enfant serait amené à réaliser. Si les maîtres étaient souvent perçus dans l’imaginaire populaire comme des parents adoptifs sommés de traiter leurs apprentis en « bon père de famille », la notion — même passée dans le langage des prud’hommes et des tribunaux — dit peu des rapports réels entretenus avec leurs élèves. De fait, les conditions de travail de l’apprenti semblent avoir été souvent rudes, ce qui n’étonne guère si l’on considère l’âge de l’entrée en apprentissage : entre dix et quatorze ans, pour une formation de deux à cinq ans selon le métier. S’ajoutent à cette problématique celle de la durée et celle du coût des formations, quelquefois définis par les statuts des différents corps de métiers sous l’Ancien Régime. La disparition officielle des corporations eut pour conséquence la réduction de la durée moyenne des contrats, alors que la disparité — la concurrence — entre les villes et les maîtres acquit une importance nouvelle. On vit parallèlement croître une forme de précarité : le plus souvent écrits au xviie siècle, et signés au cours d’une cérémonie en présence d’un notaire et de la corporation, les contrats devinrent majoritairement oraux au xixe siècle. Plusieurs signes de l’évolution des rapports hiérarchiques sont par ailleurs identifiés : ainsi, tandis que le maître était traditionnellement tenu de laisser à l’apprenti le temps libre nécessaire à son instruction et à la pratique religieuse, cette obligation se fit beaucoup plus rare au xixe siècle — ce qui contrevenait généralement au souhait des parents.
Le propos de Kaplan est ici subtil. Si l’auteur met en lumière les effets perturbateurs de la libéralisation sur les formes instituées du travail, il pointe également les difficultés concrètes de l’apprentissage. L’image de la chaîne de transmission reposant sur des liens de confiance organique, est pertinemment mise en balance avec celle du maître cherchant à tirer rapidement profit du travail d’un jeune adolescent souvent perçu comme rebelle, incapable, mal éduqué, et auquel le maître doit néanmoins transmettre un savoir-faire complexe. Dans un contexte historique où les matières premières sont rares et chères, l’apprenti est trop souvent privé de l’expérience espérée. Ne pouvant pas s’entraîner à son aise pour acquérir le « coup de main », il est invité à apprendre en regardant afin de reproduire parfaitement le geste lorsqu’il pourra plus librement manier les outils. Le modèle des corporations et les conditions concrètes de l’apprentissage ont donc connu de nombreux aléas.
Il ne faut par ailleurs pas attendre la Révolution ou l’influence des idées libérales pour que l’État s’attache à réguler l’apprentissage. Dès le xviie siècle, il entre en concurrence avec les corps intermédiaires auxquels il revient alors d’encadrer les pratiques de formation — en garantissant la validité des contrats, en jugeant tel ou tel litige, en validant tel brevet. Par suite, le contrôleur des finances Colbert contribue à encadrer les corporations : l’autorité étatique s’octroie la légitimité et le pouvoir, afin de définir les formes du travail. Le contrôle social par la communauté professionnelle se trouve dès lors réduit. On croit connaître les effets du « libéralisme » révolutionnaire, qui se forge contre les corporations supprimées dès 1791 : l’apprentissage leur survit pourtant sans cadre ni structure précis, géré au gré des particularités des communautés qui subsistent en tant qu’organes d’ordre et de régulation. La législation du 12 avril 1803 cible encore l’inexécution des contrats, énumérant les responsabilités du maître et de son apprenti. La disparition progressive des communautés entraîne la création du Conseil des prud’hommes, témoignant de la persistance d’un besoin d’organes officiellement indépendants de l’exécutif (sans se confondre désormais avec le maître) permettant de rendre justice dans le domaine de l’apprentissage. Le maintien d’une justice professionnelle manifeste ainsi sa nécessité.
La Révolution industrielle voit se succéder les tentatives de création de lois sur l’apprentissage, dont la grande loi de 1851 reste la plus marquante. Aucune démarche législative ne remit pourtant en cause les dynamiques inhérentes aux impulsions libérales du siècle. Les lois se contentèrent de compenser des dérives par une plus forte intervention de l’État. L’histoire de la réglementation de la formation professionnelle rejoint ici la régulation progressive du travail des enfants. La loi Joubert fixe en 1874 l’âge minimal de début d’apprentissage à 12 ans et interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans. C’est dans le même élan que furent créés les inspecteurs de l’apprentissage et que l’instruction des enfants devint obligatoire.
Avec la disparition des corporations, l’apprentissage a donc entamé une longue phase de mutation, et l’on peut à bon droit affirmer qu’un modèle faisant l’unanimité reste à trouver. Par-delà la dénonciation de « maîtres prédateurs » ou de « spéculateurs », voire de « parents cupides », reste à établir le cadre d’une formation professionnelle utile à la communauté. Si bien des pays européens proposent aujourd’hui des exemples, l’approche historique a le mérite de poser franchement et nouvellement une question, sans simplisme : pour sortir de la crise de notre « système » de formation, faut-il miser sur l’école ou bien sur l’atelier ?
Thomas Asselin
Le 28/09/2025
Steven L. Kaplan, Transmettre, Soumettre, Socialiser. Essai sur l’Apprentissage de Colbert à la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2023, 904 p.