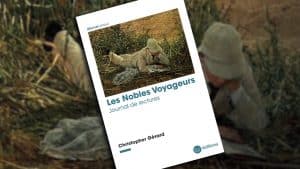Grand romancier français de la moitié du XXe siècle, Julien Gracq est connu des initiés mais moins des grandes foules. Ami d’Ernst Jünger qui le considère comme le meilleur romancier de son époque, son œuvre est imprégnée par sa lecture des Falaises de marbre, l’expérience de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par sa passion pour Wagner et une certaine mystique de la forêt. Ses romans de l’attente Un balcon en forêt et Le Rivage des Syrtes sont marqués de la pensée de Nietzsche et mettent en scène des héros pris dans l’attente d’une guerre qui ne vient jamais, où la proximité de la mort rend la vie plus exaltante : « Le monde n’est justifié qu’aux dépens éternels de sa sûreté ». Le Rivage peut en outre se comprendre comme une parabole de la chute de notre civilisation.
Julien Gracq, de son vrai nom Louis Poirier, est né en 1910 dans le Maine-et-Loire. Méconnu du grand public, il est l’un des derniers grands écrivains français, publié de son vivant dans la Pléiade. Professeur de géographie, normalien et agrégé, il a écrit entre la fin des années 30 et les années 50 quatre romans de fiction (ce qui est peu) et une pièce de théâtre, avant de se concentrer sur des écrits plus biographiques, notamment sur son expérience de la guerre, ou des descriptions de lieux mêlant poésie en prose et réflexions géographiques, ainsi que des écrits de critique littéraire. Il fut membre du parti communiste durant les années de 1936 à 1939, le quittant à la suite du pacte germano-soviétique. Mobilisé durant la 2nde guerre mondiale dans l’infanterie, il est fait prisonnier à Dunkerque avant d’être rapidement libéré par les Allemands pour raisons de santé. Il restera toujours marqué par l’expérience de la drôle de guerre qui se retrouve dans deux de ses romans (Le Rivage des Syrtes et Un balcon en forêt) qui sont des romans de l’attente, où le héros attend la bataille durant tout le récit. C’est en décembre 1943 qu’il découvre Sur les falaises de marbre d’Ernst Jünger qu’il dévore d’une traite. Ce court roman a infusé tous les récits de fiction de Gracq, notamment son chef d’œuvre Le Rivage des Syrtes. Il devint ami de Jünger qui le considérait comme le meilleur romancier de son époque. Gracq fut fasciné en outre par l’œuvre de Richard Wagner, en particulier son opéra Parsifal qui a inspiré son premier roman et sa pièce de théâtre.
Nous allons plus nous concentrer ici sur son œuvre de fiction, qui fait écho à certaines de nos préoccupations et à nos sensibilités. Cette œuvre de fiction se compose de quatre romans, un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre dont la trame est directement tirée du Parsifal de Wagner. En particulier, nous allons parler de son chef d’œuvre, Le Rivage des Syrtes. Mais d’abord, il est important de comprendre son rapport à la littérature.
Cultivant un rapport détaché et critique au milieu de la littérature, il a refusé le Goncourt en 1951 pour Le Rivage des Syrtes et a publié en 1949 La littérature à l’estomac, pamphlet où il démolit le monde littéraire de son époque à la suite de l’échec de sa pièce de théâtre Le roi pêcheur dont l’intrigue était tirée du Parsifal de Wagner. Dans ses écrits critiques, il fait l’éloge des romantiques allemands (notamment Novalis) et parmi bien d’autres thèmes évoque régulièrement Wagner et son opéra Parsifal qui ont eu une place déterminante pour sa conception de l’art et du sacré. Gracq n’est pas croyant. Il a vu Parsifal à 18 ans et fut marqué à la fois par son esthétique que par sa conception du sacré (cf. conception de « festival scénique sacré » pour Wagner), et le caractère « totalisant » de l’œuvre wagnérienne. Il parle dans un entretien en 2000 de « l’emprise totalitaire » et de « l’ébranlement affectif » qu’a l’opéra wagnérien sur lui. Son recueil de textes de critiques littéraires Préférences nous donne plusieurs éléments de sa pensée. Dans son texte sur le poète allemand Novalis, il fait du romantisme un « printemps sacré ». Dans son « Lautréamont toujours » il considère que l’âge de raison a commencé avec le XVIe siècle et s’apprête à se clore aujourd’hui après un long cycle qui correspond à la domination du rationalisme, du positivisme, etc, avec un retour de « poussées de l’irrationnel » qui se manifesteraient par de « courtes et brûlantes poussées ». Il rejoint là tout un argument irrationaliste que l’on retrouve parmi les anti-Lumières chez Nietzsche ou Bergson, où l’élan vital et l’art sont perçus comme des dépassements de la raison. Nous pouvons aussi y voir sa propre expérience du XXe siècle et des totalitarismes. Dans sa conférence « Pourquoi la littérature respire mal » de 1960, publiée dans son recueil de textes critiques Préférences, il se rapproche de Spengler qu’il cite nommément en dénonçant l’invasion de la technique et de la réflexivité dans le roman (il dénonce là le Nouveau Roman), le dépérissement de la poésie du fait la perte de contact direct avec le fonds de culture commun latin et donc la baisse d’élan vital de notre civilisation. Pour lui tous les poètes français étaient avant tout des latinistes qui étaient au contact direct de la source de la langue française et de notre culture. Les surréalistes, école de poésie née après 1920, serait la première dont la grande majorité des poètes n’a jamais appris un mot de latin. Seul Montherlant poursuivrait la tradition de la citation latine. Il cite alors Spengler sur la différence entre culture et civilisation : l’écrivain actuel ne se nourrirait plus que par œuvres de l’esprit que de l’âme, œuvres de construction plutôt que d’expression spontanée. L’envahissement de la technique dans l’écriture littéraire serait devenu une obsession durant les dernières décennies. Il blâme ici l’écriture automatique des surréalistes qui ne serait qu’une technique de plus. Il tacle notamment le Nouveau Roman de Robbe-Grillet et le roman existentialiste de Sartre. Gracq évoque comme recours, comme place où il se voit dans le panorama de la littérature, « le guerrier retiré du monde des Falaises de marbre, qui herborise au bord de l’incendie d’un monde finissant ».
C’est cette position qui est mise en avant dans Le Rivage des Syrtes. Nous allons désormais aborder plus directement son œuvre. Dans ce roman publié en 1951, le héros-narrateur Aldo est un jeune homme issu d’une des plus vieilles familles d’Orsenna, une république fictive sur le déclin, cité-Etat à mi-chemin entre Venise, Gênes et Rome, assoupie par une trop longue paix et placée dans une époque indéterminée qui ressemble tantôt à l’Antiquité tantôt au Moyen Âge. S’ennuyant, il demande à être envoyé comme observateur dans une forteresse des provinces du sud, sur le rivage des Syrtes, forteresse qui surveille l’ennemi héréditaire d’Orsenna, le Farghestan. Ils seraient théoriquement en guerre depuis trois siècles, malgré une paix de longue date. Il découvre alors le quotidien de la forteresse, sa salle des cartes, lieu initiatique du roman, se lie d’amitié avec le vieil officier Marino, blasé, et noue une relation amoureuse avec Vanessa, elle aussi membre de l’aristocratie d’Orsenna et descendante d’un aïeul qui avait trahi Orsenna pour le Farghestan. Elle semble suivre le destin de son ancêtre en complotant avec le Farghestan pour relancer la guerre. Elle influence Aldo qui finit par transgresser avec un navire de guerre l’invisible frontière maritime et devient le catalyseur de l’entrée en guerre du Farghestan. Le roman se clôt sur la phrase « Je savais désormais pour quoi le décor était planté ». Dans ce roman Gracq exprime l’idée que les civilisations trop développées engendrent un homme qui a cessé de faire peur, thèse que nous retrouvons aussi dans son roman inachevé Terres du couchant. Cela explique pourquoi une partie de l’élite d’Orsenna a trahi, cherchant à faire revenir l’Histoire et l’élan vital par la violence dans un monde assoupi : « le monde n’est justifié qu’aux dépens éternels de sa sûreté ».
Gabriel Piniés