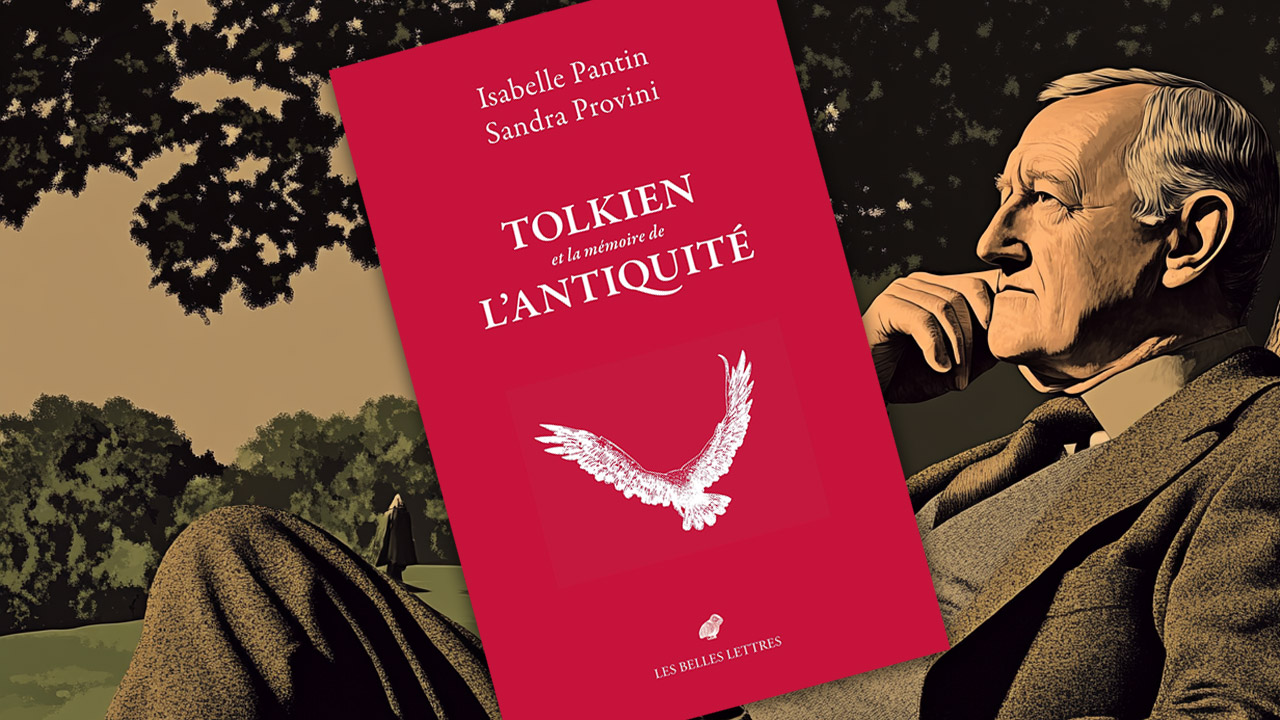Tolkien et la mémoire de l’Antiquité, d’Isabelle Pantin et Sandra Provini
Si nombres d’ouvrages ont déjà mis en lumière les traditions germaniques, scandinaves, anglo-saxonnes et celtiques ainsi que le christianisme en tant que sources d’inspiration dans l’œuvre de Tolkien, peu de livres ont exploré la trace de l’héritage antique dans son travail. Le livre recensé ici offre la première véritable synthèse sur le sujet.
Il existe une multitude de publications consacrées aux sources d’inspiration dans lesquelles J. R. R. Tolkien a puisé. La plupart se concentrent sur les résonances médiévales présentes dans son œuvre.
Celles-ci sont de nature variée : elles relèvent des traditions germaniques continentales, mais aussi scandinaves, anglo-saxonnes et celtiques. L’œuvre du Professeur est également profondément marquée par le christianisme, quoique de manière plus diffuse, « comme une lampe invisible ». Cette matière chrétienne a déjà donné lieu à de nombreuses études. À ces deux ensembles peut s’en ajouter un troisième, plus rarement exploré : l’Antiquité. Cet héritage, souvent évoqué mais rarement étudié en profondeur, semble pourtant avoir joué un rôle non négligeable dans le processus d’écriture de Tolkien.
C’est précisément ce que cherchent à mettre en lumière Isabelle Pantin et Sandra Provini. Jusqu’à une date récente, la matière antique n’avait guère fait l’objet de travaux systématiques. Quelques volumes collectifs, en anglais comme en français, ont cependant vu le jour ces dernières années, proposant des études ponctuelles. Le livre recensé ici se distingue en ce qu’il offre la première véritable synthèse sur le sujet. Une étude d’ensemble qui tente d’approcher la mémoire de l’Antiquité en trois temps : la culture antique de Tolkien, la présence du monde grec et latin dans son œuvre (approche temporelle, spatiale et de la nature) et enfin les échos de la tragédie et de l’épopée antique dans les récits de la Terre du Milieu.
Très jeune, Tolkien a reçu de sa mère une initiation au latin, qui marqua durablement sa formation. Il apprit le grec à l’adolescence. Les langues classiques l’accompagnèrent tout au long de son parcours scolaire puis universitaire. Le latin demeura par ailleurs la langue de sa pratique religieuse, présente dans sa vie quotidienne. Cette fréquentation continue du latin et du grec a joué un rôle décisif dans l’élaboration des langues elfiques inventées par Tolkien : le quenya et le sindarin doivent beaucoup, dans leur structure et leur esthétique, aux modèles classiques – le finnois et le gallois ont également contribué à leur élaboration. Et l’on sait que sans la création de ces langues, surtout du quenya, Tolkien n’aurait pas tiré de sa réflexion sur la langue une réflexion sur l’histoire et le besoin d’écrire, de dire, de raconter. De la langue vient l’histoire chez Tolkien.
L’étude aborde une matière délicate. Contrairement aux traditions chrétiennes ou germaniques médiévales, la présence de l’Antiquité chez Tolkien ne se donne pas immédiatement à voir. Elle doit être reconstituée à partir d’un faisceau d’indices, ce que suggère d’ailleurs le terme de « mémoire » choisi pour le titre, qui renvoie à l’idée d’une tradition fragmentée, réfractée. La première tâche consiste donc à reconstituer les lectures grecques et latines de Tolkien – Homère ayant sans doute été le plus marquant. À cet égard, l’ouvrage d’Oronzo Cilli, Tolkien’s Library: An Annotated Checklist, publié il y a quelques années, fournit de précieux éclairages et a été abondamment sollicité par Pantin et Provini. Il ressort de ce bilan que Tolkien a beaucoup fréquenté les auteurs antiques, compte tenu de sa formation, même si certaines lectures semblent avoir manqué. On peut supposer que le passage de ses études classiques aux études anglaises, avec une spécialisation scandinave, a pu freiner l’approfondissement de son bagage antique. Pourtant, aucun médiéviste ne saurait ignorer totalement cet héritage, tant il imprègne le Moyen Âge.
De fait, Tolkien a lu et relu les historiens grecs et latins, classiques ou tardifs, surtout lorsqu’ils traitaient des Germains – Tacite ou Jordanès, par exemple. Il faudrait également tenir compte, même si cela excède le cadre de l’ouvrage, des auteurs médiévaux latins qui s’appuyaient eux-mêmes sur l’historiographie antique. On sait que les lettrés médiévaux, lorsqu’ils écrivaient en latin, ne le faisaient jamais sans référence aux auteurs classiques. Le Moyen Âge est d’ailleurs la période qui a le mieux préservé les textes antiques, transmis par le biais des manuscrits. Ainsi, dans ces rapports étroits entre Antiquité et Moyen Âge, Tolkien apparaît presque comme un clerc médiéval ou, comme le suggèrent Pantin et Provini en conclusion, tel un humaniste de la Renaissance. Un humanisme régi par un principe de l’« innutrition » (p. 309), « selon laquelle il faut assimiler si pleinement les plus beaux textes anciens qu’ils vous aident à découvrir votre propre langue, plus intimement personnelle et plus richement expressive que celle que l’on acquiert de l’usage courant ».
En ce qui concerne le rapport à l’espace et au temps, si la Terre du Milieu est souvent associée à l’Europe du nord-ouest – ainsi que l’écrit Tolkien à plusieurs reprises dans sa correspondance –, le fait d’inclure les contrées du sud permet d’étendre l’univers (p. 156) : « L’action de l’histoire se déroule dans le nord-ouest de la “Terre du Milieu”, à une latitude équivalente à celles des côtes de l’Europe et des rivages du nord de la Méditerranée. Si l’on place Hobbiteville et Fendeval à peu près à la latitude d’Oxford, alors Minas Tirith, 1000 km plus au sud, est à peu près à celle de Florence ; les bouches de l’Anduin et Pelargir, l’ancienne cité, à celle de la Troie antique. » Tolkien propose des relations entre notre monde et le sien. On pourrait ajouter à cela l’extrait de lettre citée quelques pages plus tôt (p. 153) : « Le décor de mon récit est cette terre, celle sur laquelle nous vivons à présent, mais la période historique est imaginaire. Les [traits essentiels de ce lieu permanent] sont tous présents (en tout cas pour les habitants du nord-ouest de l’Europe), et il est naturel qu’il paraisse familier. » Ces « traits essentiels », en ce qu’ils sont présents, permettent de se détacher d’une représentation de notre monde, dont celui de Tolkien ne serait qu’un décalque. Tolkien invente, innove, propose ; il ne recopie pas, il n’imite pas. La multitude de ses références se retrouve agencée selon un ordre nouveau, issu de sa volonté d’écrivain. La Terre du Milieu, qui serait un continent précédant le nôtre, ne l’est que pour partie.
La mémoire antique dans son œuvre se manifeste sous diverses formes. Il serait vain de passer en revue tous les éléments tenant à cette matière. On sait que la présence des villes, des architectures urbaines, voire des routes qui traversent la Terre du Milieu, constitue sans doute un héritage antique. La part belle de la mémoire revient néanmoins à la littérature. Avec un appui constant sur les textes de Tolkien, les auteurs retrouvent des traces de cette présence antique, depuis les premières versions du Silmarillion en passant par Le Hobbit, et jusqu’aux pages ultimes du Seigneur des Anneaux.
Indiquons ici quelques points particulièrement intéressants : 1) Le mythe orphique « inversé » que l’on retrouve dans l’histoire de Beren et Lúthien ; la forêt qui entoure Orphée au livre X des Métamorphoses fait penser au Rassemblement des Ents dans Les Deux Tours. 2) Le mythe d’Œdipe et son adaptation dans l’histoire de Túrin Turambar narrée dans Les Enfants de Húrin. 3) Le motif de la catabase, avec Gandalf affrontant le Balrog, ou Aragorn se frayant un passage sur le Chemin des Morts. 4) Le retour des Hobbits dans le Shire à la fin du Seigneur des Anneaux faisant penser au retour d’Ulysse à Ithaque à la fin de l’Odyssée, un « retour dans un pays ravagé, qui ne permet pas au héros victorieux de bénéficier du repos mérité après la guerre » (p. 278).
Il faut enfin revenir sur la définition générique du Seigneur des Anneaux selon Tolkien. Il s’agit d’un « poème héroïque élégiaque ». Cette double tonalité, aux apparences contraires, s’articule en réalité pleinement. De là un héroïsme aux bases antiques, mais remodelé. De là les rapprochements tout à fait fondés avec l’Énéide (p. 300) : « Tolkien fait toujours le choix de la pietas virgilienne plutôt que du kleos homérique : ainsi, le personnage du pieux Faramir, qui ne cherche pas la gloire, contraste avec celui de son frère Boromir, et sera fondateur d’une dynastie. »
L’ouvrage recensé répond ainsi aux attentes. Il propose, de manière tout à fait accessible, un panorama de la mémoire antique dans l’univers tolkienien, tout en jetant les bases d’un champ de recherche encore en friche. Un bel effort de synthèse. On peut espérer qu’il incitera d’autres amateurs de l’œuvre de Tolkien à explorer d’autres traditions tout aussi influentes mais moins étudiées, telle la matière celtique, qui n’a toujours pas fait l’objet d’une synthèse en langue française. Peut-être ce livre contribuera-t-il, en somme, à élargir l’horizon des études tolkieniennes vers l’ensemble des héritages culturels qui irriguent cette œuvre.
Armand Berger
Le 04/11/2025
Isabelle Pantin & Sandra Provini, Tolkien et la mémoire de l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2025, 380 p.