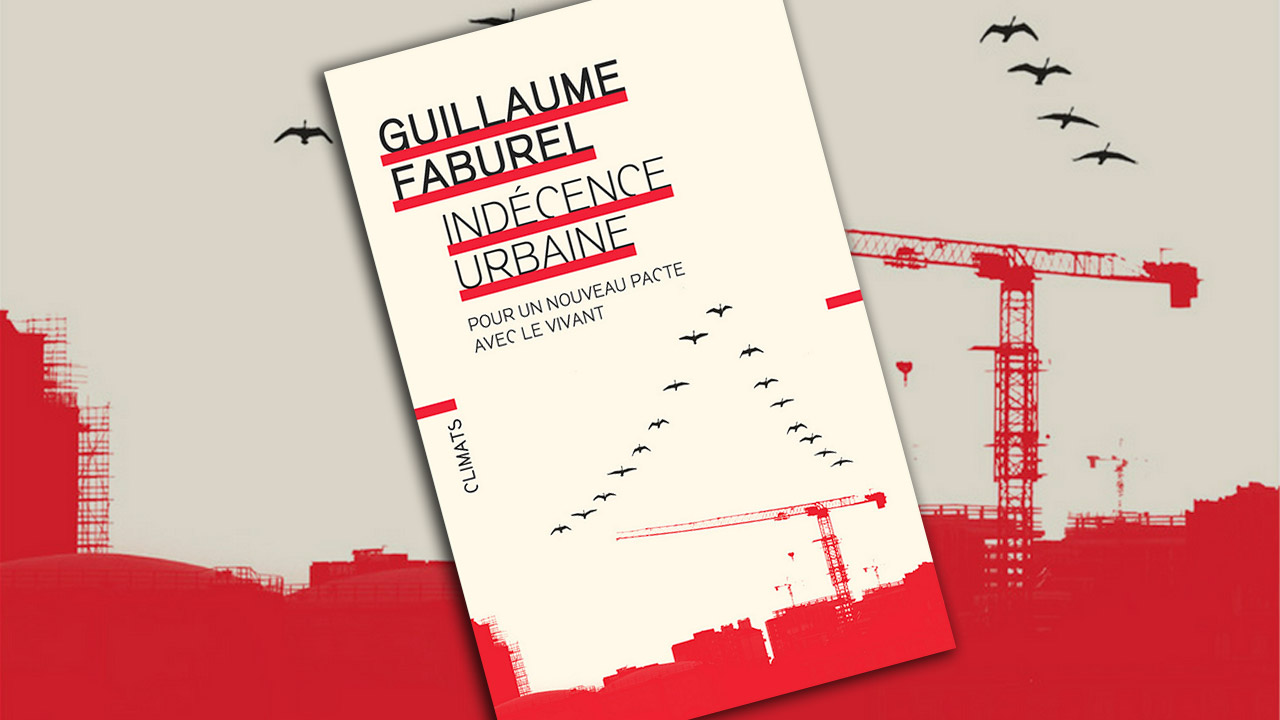Indécence urbaine. Pour un nouveau pacte avec le vivant, de Guillaume Faburel
Guillaume Faburel, géographe critique de la métropolisation, voit dans l’urbanisation massive une catastrophe écologique issue du productivisme et du consumérisme. Il plaide dans Indécence urbaine (2023) pour une désurbanisation via la convivialité rurale et un nouveau pacte écologique-social. Bien qu’on y trouve des idées intéressantes, en égratignant le vernis anarchiste de son discours, on peut se demander si, en vantant le « ré-empaysannement » des campagnes contre la modernité des villes, ce livre n’est pas au fond profondément réactionnaire.
Géographe spécialisé dans l’étude des villes, Guillaume Faburel construit depuis plusieurs années une approche critique de la métropolisation, dont il considère l’ampleur actuelle comme un résultat de l’abondance productiviste et de l’opulence consumériste, mais surtout comme une catastrophe écologique sans équivalent. Après la parution des Métropoles barbares en 2018, il publie Indécence urbaine en 2023 comme un plaidoyer qui invite à désurbaniser nos modes d’habiter pour construire, à travers la convivialité du monde rural, un nouveau pacte écologique et social (un choix déjà assumé par Jean-Claude Michéa). Si la thèse prend clairement le contre-pied des tendances résidentielles du XXe siècle pour aborder un sujet qui deviendra « brûlant » au XXIe, elle s’inscrit dans un mouvement critique très actuel qui peine parfois à distinguer la ratiocination idéologique des réalités objectivement établies.
La première partie du livre traite assez subtilement de la croissance urbaine et du stade civilisationnel de métropolisation généralisée auquel elle aboutit aujourd’hui. L’histoire urbaine se résumerait en effet à une double domestication, celle de la nature par l’agriculture qui conduit à la sédentarisation, et celle de l’homme par le développement d’institutions et de gouvernements plus ou moins autoritaires. Mais deux révolutions récentes changent la donne. C’est d’abord l’industrialisation qui transforme la ville en dispositif d’extractivisme et de productivisme. C’est ensuite l’économie libérale qui fait de la condition urbaine le nouveau moteur de la condition humaine, totalement détachée de l’environnement et dénuée de tout rapport au vivant. La densité bétonnée, « isomorphe de la culture industrielle et capitaliste », en est l’« arme de construction massive », si bien que la concentration urbaine provoque finalement un désastre. La surconsommation foncière, le tassement des sols et les îlots de chaleurs caniculaires en sont les maux tangibles dans nombre de grandes métropoles, mais ils ne suffisent pas à atténuer le panégyrique urbain, qui demeure un nec plus ultra environnemental que tout le monde souhaite atteindre ou imiter. La densité est en effet souvent présentée comme solution pour réduire l’emprise géographique des sociétés et des activités humaines. À juste titre, Guillaume Faburel y voit au contraire une rupture totale entre les sociétés et les écosystèmes, qui ne peut se traduire à terme que par un pis-aller dont les conséquences écologiques seront de plus en plus difficiles à contenir par les techniques de géo-ingénierie et les colifichets d’un urbanisme dit durable, transitoire ou tactique, mais qui n’est en réalité rien d’autre qu’ornemental.
Tout cela s’entend sans difficulté. Du moins si l’on gratte le vernis sous lequel Guillaume Faburel veut faire reluire ses idées pour les acclimater à la mode anticoloniale et anti-patriarcale de l’extrême-gauche. Était-il utile, pour dénoncer les expérimentations urbaines d’incitation comportementale (nudge), de fantasmer un « urbanisme militaire » qui, au nom de la marchandisation des espaces de vie, aurait fait de la ville une « arme de guerre » ? Fallait-il vraiment considérer la crise actuelle des migrants, et l’accueil médiocre qui leur est fait, comme un argument pour disqualifier encore davantage les tentations concentrationnaires urbaines ? Était-il nécessaire d’imaginer, sans plus d’arguments, que la ville assigne de facto aux stéréotypes de genres et au harcèlement de rue en oppressant les femmes ? Même s’il dénonce le discours dominant des universitaires dont il fait partie, Guillaume Faburel n’en reste pas moins une fashion victim.
Dans cette logique, la deuxième partie du livre invite naturellement à « habiter autrement la Terre » à travers une idée originale : la « décolonisation féconde de nos imaginaires croissancistes de vie urbaine » (sic). On y trouve des idées intéressantes, à rapprocher des réflexions d’Aristote ou des socialistes utopiques du XIXe siècle (Fourier, Howard, Owen). Guillaume Faburel rappelle par exemple que 200 personnes suffisent pour créer une communauté de vie solidaire et autonome, et qu’un regroupement de 20 000 personnes permet de répondre à tous les besoins essentiels, notamment administratifs et sanitaires. Il en conclut que nos villes ne devraient pas dépasser 30 000 habitants et s’organiser en densités faibles et déconcentrées, limitant les déplacements par le recours au télétravail. L’habitat pourrait y être plus léger, bioclimatique, et surtout réduit en surface pour maximiser la vie au-dehors et refaire contact avec la nature. Il n’est d’ailleurs même pas nécessaire de fabriquer cet habitat puisqu’il existe déjà dans la ruralité de la diagonale du vide, trop longtemps abandonnée au profit de la nébuleuse métropolitaine. Le mot d’ordre qui en découle est simple et radical : « déménager et faire sécession », en instaurant une néo-paysannerie d’« écovillages » dans une perspective d’auto-suffisance (économie alternative, écologie, vie communautaire active) qui rappelle les expériences Longo Maï.
Pour autant, n’y a-t-il pas derrière ce projet un risque crispant, celui du repli sur soi ? Ce serait le cas si l’idée était portée par des « discours identitaires » réactivant un « imaginaire rance » pariant sur l’« isolationnisme propriétaire des plus forts et sur la pureté nauséabonde de leur “civilisation” […] blanche et occidentale, hétérosexuelle et patriarcale ». Mais quand Guillaume Faburel en parle, il s’agit au contraire d’une solution salvatrice qui relève de la « filiation anarchiste de l’écologie profonde », et qui invite au « ré-empuissantement de nos capacités », à l’« occupation désobéissante » et au « ré-ensauvagement de nos pensées ». Alors, par amour de la provocation et du jeu, comme tout est visiblement permis dans les discours qui se veulent anarchistes, disons-le comme on pourrait le penser de prime abord : parce qu’il prône le « ré-empaysannement » des campagnes face à la modernité des villes, le livre de Guillaume Faburel est fondamentalement réactionnaire ; parce qu’il délivre des recettes radicales qu’il suffirait d’appliquer pour le bien-être de l’humanité, c’est un livre fasciste. Tout ce contre quoi il souhaitait lutter. Dommage…
Nicolas Zander
Guillaume Faburel, Indécence urbaine. Pour un nouveau pacte avec le vivant, Paris, Climats, 2023, 336 p.