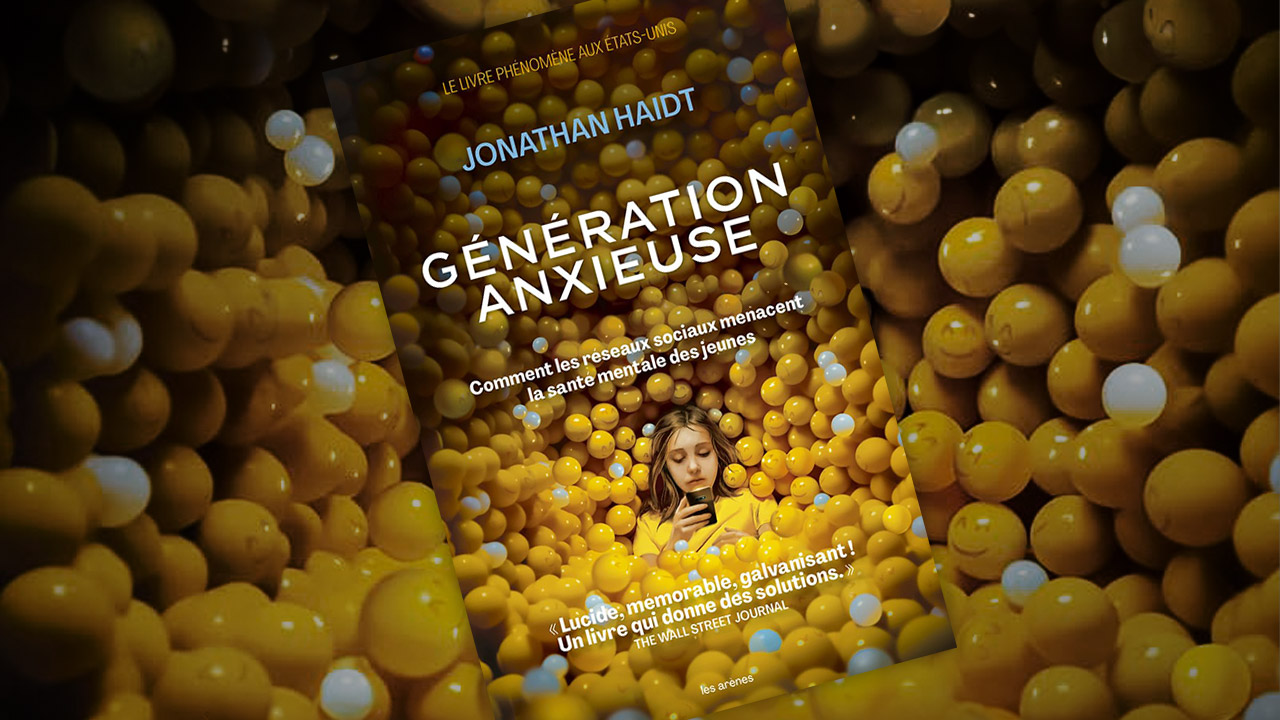Génération anxieuse, de Jonathan Haidt
Dépressions, scarifications, comportements autoagressifs ou encore suicides… les enfants et adolescents modernes sont devenus une « génération anxieuse ». Pour l’auteur américain, Jonathan Haidt, ces comportements ne sont pas dus à la guerre, au chômage, ou au changement climatique, mais à la transformation digitale de notre société.
Le livre Génération anxieuse du sociopsychologue américain Jonathan Haidt est une de ces publications qui présentent de façon scientifique ce que l’expérience quotidienne et le sens commun nous disent depuis longtemps : l’effet des technologies digitales sur les enfants et les adolescents est désastreux.
Pour le démontrer, Haidt mobilise une grande quantité de données, qui laissent toujours apparaître le même tableau : entre 2010 et 2015, une série de nouvelles technologies – l’accès au haut débit, la généralisation du smartphone et le perfectionnement des images virtuelles – a eu l’effet d’une grande reconfiguration pour le cerveau des enfants et adolescents. L’importante augmentation des dépressions (de 145 % chez les filles, 161 % chez les garçons aux États-Unis depuis 2004) et des troubles anxieux (de 139 % chez les individus entre 18 et 25 ans aux États-Unis), des comportements autoagressifs (de 188 % chez les filles, 48 % chez les garçons aux États-Unis depuis 2004) et des suicides (de 167 % chez les filles, 91% chez les garçons aux États-Unis depuis 2010) ainsi que des automutilations ou des scarifications (de 78 % chez les filles, 134 % chez les garçons en Grande-Bretagne), observable au-delà des différences de statut social ou d’origine ethnique dans l’ensemble du monde occidental, laisse penser que ce processus n’est pas neutre.
La « Génération Z », regroupant ceux qui sont nés après 1995, est particulièrement touchée. Dans le cadre d’une enquête menée en 2015, un quart des interrogés déclaraient être « presque constamment » en ligne ; entre temps, ce nombre a presque doublé, avec 46 %. Et ce tandis que l’utilisation des médias connectés varie de façon significative entre les filles et les garçons : les garçons sont surtout touchés par les jeux vidéo, YouTube, Reddit et la pornographie hardcore, les filles par les réseaux sociaux, avec leurs partages et leurs pouces bleus. Quoi qu’il en soit, ces occupations ont pour conséquence de les soustraire durablement aux conditions qui permettent aux humains de gagner en maturité : les interactions physiques, ici et maintenant, qui développent la perception sociale et au cours desquelles la rencontre de deux individus ou d’un individu avec un groupe devient un facteur essentiel pour le sentiment d’appartenance à une communauté. Le monde virtuel, au contraire, est désincarné, l’interaction se déroule de manière asynchrone, souvent par l’écrit, elle connaît presque uniquement l’interaction avec plusieurs autres, sous anonymat, ce qui signifie que l’appartenance à la communauté peut prendre fin à tout moment, en un seul clic.
Haidt cite la formule de Sherry Turkle, professeur au MIT : « Nous sommes toujours ailleurs. » Cela a pour conséquence que l’individu, dans une phase de sa vie dans laquelle il est particulièrement irritable, se sent vite « isolé, esseulé ou inutile ». Et il n’y a pas nécessairement de raisons objectives à cela. Haidt contredit en tout cas l’affirmation selon laquelle la « génération anxieuse » réagirait aux menaces réelles de la guerre, du chômage, du changement climatique ou de la destruction de l’environnement. Il réfute cette argumentation en attirant l’attention sur le fait que par le passé, aucune situation semblable, ni surtout aucune situation véritablement actuelle – et non seulement projetée ou imaginée dans un futur plus ou moins proche – n’a déclenché des réactions psychiques comparables : « Lorsque des pays sont attaqués, militairement ou par des terroristes, les gens, en général, se rassemblent autour du drapeau et autour de leurs concitoyens. Ils font preuve de plus de détermination, le taux de suicide baisse, et les chercheurs ont même découvert que les individus qui étaient adolescents au début d’une guerre font preuve de plus de fiabilité et de coopération dans des expériences en laboratoire. »
Pour Haidt, la transformation digitale a conduit à une situation absurde : nous possédons les moyens légaux dans le monde analogique pour empêcher les mineurs d’accéder aux drogues, à l’alcool, au tabac ou aux jeux d’argent, mais factuellement, nous n’avons pas le moindre contrôle sur ce qu’ils font dans le monde virtuel. Il est également important de noter qu’il ne passe pas sous silence le lien entre les développements précédemment décrits et le processus qui, dans les années quatre-vingt, a mené à un changement de style éducatif lourd en conséquence. Celui-ci a vu s’imposer la pédagogie « douce » et avec elle, la surprotection des enfants. Haidt souligne que la disparition du « jeu libre » sans la surveillance des adultes a certes réduit toute une série de potentiels dangers, mais que dans le même temps, c’est également la probabilité de vivre des expériences négatives qui s’est amenuie – depuis la douleur corporelle jusqu’aux phénomènes d’exclusion, en passant par les humiliations. Des expériences qui, jadis, avaient l’importante fonction de préparer les enfants aux âpres défis que la vie leur réservait.
Sur ce point, il est toutefois difficile de se départir de l’impression que Haidt, de fait, sous-estime l’importance de la perte d’autorité parentale. Ce qui laisse subsister des doutes quant à l’efficience des seules solutions qu’il propose : pas de smartphone pour les moins de quatorze ans, pas d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de seize ans, pas de smartphones ou appareils similaires à l’école, davantage de jeux et d’activités autonomes sans la présence d’adultes.
Le scepticisme est aussi de bon aloi parce que Haidt a, sur ce terrain, un prédécesseur en la personne de Neil Postman. Celui-ci fit paraître il y a exactement quarante ans le livre Se distraire à en mourir, dans lequel il alertait quant aux conséquences de l’esseulement dans la société de l’abondance, ainsi que d’une consommation de médias – assez inoffensive comparé à aujourd’hui – qui le laissait penser que plus aucun effort intellectuel n’était requis et que le besoin de divertissement était exploitable à l’infini : « Nos mécanismes de défense contre les torrents d’informations se sont effondrés ; notre système immunitaire contre les informations ne fonctionne plus. Nous souffrons d’une sorte de sida culturel. » Le livre de Postman, à l’instar de la Génération anxieuse de Haidt, était un bestseller. Qu’a-t-il provoqué ? Rien.
Karlheinz Weißmann
Le 06/07/2025
Jonathan Haidt, Génération anxieuse. Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes, Paris, Les Arènes, 2025, 424 p.