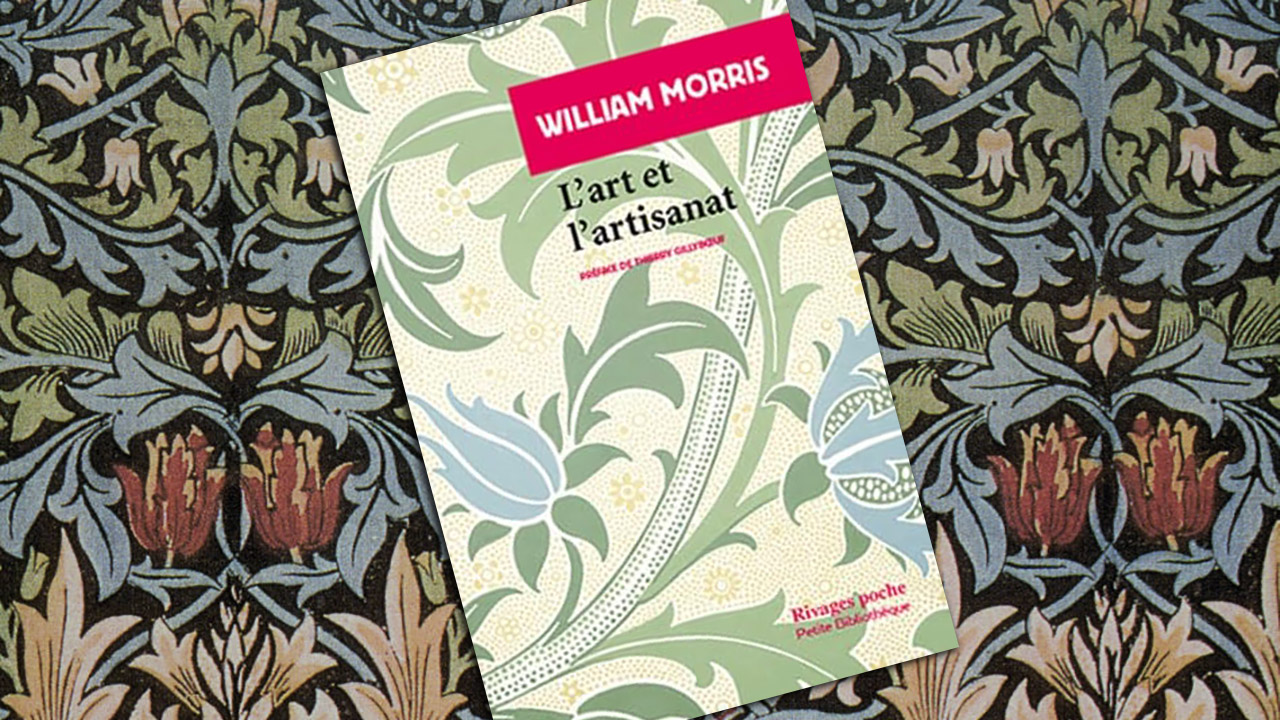L’Art et l’Artisanat, de William Morris
En trois discours, William Morris esquisse une utopie de la beauté partagée où art et travail réconciliés fondent une civilisation. Entre romantisme révolutionnaire et foi humaniste, son appel à la dignité du geste résonne.
Poète, traducteur des mythes gréco-romains et des sagas nordiques, passeur des traditions germanique et celtique, imprimeur, décorateur, militant socialiste, fondateur du mouvement Arts & Crafts, héritier des préraphaélites et disciple de John Ruskin (1819-1900), William Morris (1834-1896) incarne l’idéal humaniste d’un homme total nourri par la longue mémoire européenne. Idéologue praticien, il mit à l’épreuve ses théories dans son atelier, unissant main, pensée et beauté contre la misère esthétique et morale d’une Angleterre industrielle. Au-delà de la réforme des arts décoratifs, son projet relève d’un romantisme révolutionnaire, au sens que Michaël Löwy (Révolte et mélancolie. Le romantisme à l’ère du capitalisme, 1992) donne à cette expression – cette attitude qui fait de la nostalgie de l’unité communautaire perdue une énergie de transformation du présent.
À travers L’Art et l’Artisanat (1883-1891), recueil de trois conférences traduites par Thierry Gillybœuf dans une langue claire, fidèle au ton de l’orateur, Morris interroge le lien entre art, travail et civilisation : quelle place accorder à la beauté dans une société juste ? À rebours du paradigme contemporain fondé sur la vitesse, le profit et l’obsolescence, sa pensée utopique et prescriptive frappe par son actualité lucide. Elle contredit notre système de valeurs tout en lui tendant un miroir : son appel à la beauté, au soin et à la coopération résonne dans un monde saturé de production et de déracinement. Hérésie hier, urgence aujourd’hui.
Le premier discours, L’Art et l’artisanat d’aujourd’hui, prononcé à Édimbourg le 30 octobre 1889 devant la National Association for the Advancement of Art, constitue le cœur du recueil. Morris y défend une idée essentielle : le travail doit être une joie, et l’art, la condition de cette joie. « L’art est la création de l’homme qui ajoute sa part à la beauté du monde. » Cette beauté répond à un besoin vital : « L’homme ne peut pas vivre sans plaisir dans son travail, pas plus qu’il ne peut vivre sans manger. » La révolution industrielle a dissocié la main et l’esprit, l’usine remplaçant l’atelier, la tâche répétitive étouffant la créativité. La laideur, « poison lent qui endort les peuples », n’est pas, chez Morris, une faute de goût, mais un symptôme moral. À cette décadence, il oppose une réforme esthétique et éthique : redonner à chaque objet, si humble soit-il, la dignité du Beau. Méprisé par la hiérarchie des arts, l’art appliqué devient remède de santé sociale : « Nous ne pouvons pas avoir l’art sans le travail libre. » Sans beauté, point de société.
Morris pense le monde selon une triade fondatrice : le Beau, la Main et la Cité. Discrète réminiscence de la structure humaniste des arts – mens, manus, societas – selon laquelle la pensée s’accomplit dans le geste et trouve son sens dans la communauté. Cette triade articule esthétique, éthique et politique : la beauté n’a de valeur que dans le travail, le travail de dignité que dans une société juste, et la société ne s’élève qu’en cultivant la beauté du geste et du regard. L’art se veut ainsi le lien vivant entre création individuelle, travail partagé et bien commun – la forme la plus accomplie de la civilisation. Un modèle puisé dans le Moyen Âge, mais au médiévalisme structurel, non décoratif. Dans l’esprit du romantisme révolutionnaire, Morris ne se réfugie pas dans le passé : il y cherche l’image de la communauté à venir. L’atelier gothique fantasmé devient l’allégorie d’une société harmonieuse : contre la Renaissance, qui crée l’artiste-individu, il célèbre la communauté d’artisans matrice de la beauté.
L’Art en ploutocratie, conférence donnée en 1883 devant la Society for the Protection of Ancient Buildings, dresse un diagnostic politique sans appel : le règne de la « ploutocratie », domination de la richesse sur la Cité. La logique du profit détruit la qualité, la lenteur et le sens. Jadis art de synthèse, l’architecture s’est faite commerce : « Nos villes sont devenues un champ de ruines utiles. » La machine, née pour délivrer l’homme, l’a enchaîné ; le Beau, capturé par l’élite, a quitté la Cité.
L’art véritable ne peut renaître que dans une économie du soin et de la coopération : tant que la société valorisera la quantité au détriment de la qualité, la beauté sera impossible. Ce diagnostic pressent les effets spirituels de la reproductibilité industrielle : un monde où la perte du geste entraîne celle du sens.
Enfin, L’Art : idéal socialiste, prononcé en 1891 devant la Hammersmith Socialist Society, tire la conséquence politique des précédents discours. Si « tout ce qui est fabriqué et a forme est soit œuvre d’art, soit destructeur de l’art », alors il faut refonder les conditions sociales de la production. Le socialisme de Morris est d’abord moral et esthétique : il vise à rendre le travail utile, libre et beau. Il énonce donc quatre exigences : l’accessibilité de la beauté ; le choix du travail, source de joie ; l’utilisation de la machine au service du geste humain, par fidélité à l’esprit de l’art ; la coopération entre métiers, garante d’une culture partagée. Utopique mais cohérente, la foi de Morris repose sur une conviction radicale : la justice d’une société se lit dans la beauté de ses formes.
L’unité de cette pensée éthique et esthétique fait sa force autant que sa limite. Morris confond parfois beauté et bonheur : il suppose que le bonheur est la finalité de la vie humaine et que le plaisir du travail mène nécessairement à la vertu. Cette téléologie communiste du bonheur est discutable : l’art ne sauve pas du tragique. Son utopie oublie la part de conflit inhérente à la création féconde ; sa critique du progrès néglige la puissance émancipatrice de la technique. Pourtant, cette éthique du travail habité n’est pas réactionnaire : elle fonde une métaphysique de la décence. Créer de la beauté, c’est être au monde. L’art et l’esthétique atteignent ici un tournant décisif : le passage d’une conception individuelle du génie à une conception civilisationnelle de la culture matérielle.
Le propos anticipe Walter Benjamin (L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1935) et Hannah Arendt (Condition de l’homme moderne, 1958) : chez le premier, la valeur spirituelle de l’œuvre tient à la qualité du geste reproductible ; chez la seconde, la beauté durable résiste à la consommation et fonde la permanence du monde. La filiation avec le Bauhaus, Ar Seiz Breur ou le design éthique montre combien la pensée de Morris irrigue encore nos débats : tradition et modernité, beauté et utilité, ancrage local et responsabilité sociale.
Dans un monde saturé d’objets sans mémoire, la leçon de Morris garde une force prophétique : « Ne laissez rien entrer dans vos maisons que vous ne sachiez utile ou que vous ne croyiez beau. » Credo civique plutôt que traité, L’Art et l’Artisanat rappelle que la beauté n’est pas un privilège, mais un devoir ; que la laideur est une faute politique ; que le travail, loin d’être un fardeau, peut redevenir acte de joie.
Daté dans son socialisme utopique — empreint de foi morale plus que d’analyse économique, et marqué par l’idéal fraternel du XIXᵉ siècle —, mais vivifié par sa radicalité teintée d’absolu, le texte s’inscrit dans la lignée du romantisme révolutionnaire : ce courant qui préfère la ferveur du sens à l’aridité du progrès. Morris fait de la beauté non un ornement du monde, mais son horizon ; non une rêverie, mais une politique de civilisation. À défaut d’être accomplie, l’utopie morrisienne – à la fois collective et nourrie de gestes quotidiens – mérite d’être entretenue. Une société qui réapprendrait à créer avec soin, à bâtir avec mesure et à entourer la vie de beauté ne ferait pas seulement de l’art : elle réenchanterait le monde.
Gabrielle Fouquet
Le 08/11/2025
William Morris, L’Art et l’Artisanat, traduction de Thierry Gillybœuf, Paris, Payot Rivages, 2011, 128 p.